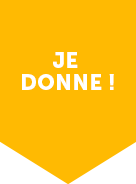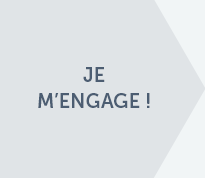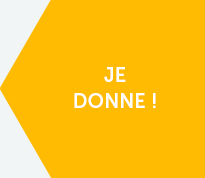Un microscope de super-résolution pour visualiser l’architecture des neurones
Mis à jour le 04/04/2025
Porteur du projet : Annie ANDRIEUX – Institut des Neurosciences (GIN – Grenoble)
Titre du projet : Architectures neuronales (axone, cône de croissance, épines dendritiques) : visualiser l’organisation du cytosquelette pour mieux comprendre certaines fonctions neuronales
Équipement financé grâce à l’opération Rotary-Espoir en Tête 2022 et sélectionné par le Conseil Scientifique de la FRC : un microscope super-résolution pour imagerie 3D-STORM pour un montant de 193 000 €
Description de l’équipement
Un ensemble de filaments présents à l’intérieur des neurones forme un squelette, appelé cytosquelette, nécessaire au bon développement et au fonctionnement de ces cellules. Des protéines spécifiques s’associent à ce cytosquelette et contrôlent son assemblage et son organisation. Dans de nombreuses pathologies du cerveau, le cytosquelette est désorganisé ce qui altère l’intégrité des neurones. Être capable de visualiser l’organisation du cytosquelette à l’intérieur des prolongements neuronaux est une nécessité pour comprendre les mécanismes à l’origine de ces pathologies. Le très petit diamètre des prolongements neuronaux (de l’ordre du micromètre) requiert l’utilisation de techniques d’imagerie en super résolution comme l’imagerie STORM qui permet une résolution à l’échelle du nanomètre.
À ce jour, la plateforme d’imagerie de l’Institut des Neurosciences de Grenoble est équipée d’un ensemble d’équipements permettant d’effectuer de l’imagerie STORM-2D, ce qui n’est plus viable à long terme et plus adapté aux nouvelles études que les chercheurs de l’institut souhaitent développer. L’installation d’un système d’imagerie super-résolutif STORM-3D permettra aux équipes de l’institut d’approfondir l’étude du cytosquelette dans le système nerveux central ainsi que son dysfonctionnement dans diverses maladies neurodégénératives (Alzheimer, Huntington) ou psychiatriques. Pouvoir utiliser cette technique d’imagerie de super résolution est absolument crucial pour plusieurs programmes de recherche dont 4 exemples sont détaillés ci-dessous :
- Projet 1: Déterminer l’impact de mutants de la protéine Tau sur le cytosquelette (équipe Andrieux/Arnal). Dans les tauopathies (Alzheimer ou démence fronto-temporale), la protéine Tau subit des modifications pathologiques conduisant à la formation d’agrégats dans les neurones. L’équipe a montré que certains mutants de Tau induisent des organisations anormales des microtubules (composants majeurs du cytosquelette en forme de tube creux). Les chercheurs analyseront les diverses organisations de protéines du cytosquelette induites par la protéine Tau normale et des mutants de Tau.
- Projet 2 : Analyser les effets de la délétion d’une protéine sur le cytosquelette (équipe Andrieux/Arnal). L’équipe a récemment découvert que la protéine MAP6 peut se localiser dans les microtubules et est nécessaire à leur stabilité. Ces microtubules contenant MAP6 pourraient être impliqués dans le maintien de la taille de l’axone (prolongement neuronal conduisant le message électrique). L’imagerie STORM-3D sera utilisée pour mesurer le diamètre moyen des axones et analyser l’organisation et la forme des microtubules dans des neurones sauvages ou délétés de la protéine MAP6.
- Projet 3 : Identifier les effets de variants de l’Aβ sur le cytosquelette (équipe Buisson). L’autoréplication et la propagation des peptides Aβ dans le cerveau sont des événements très précoces dans l’évolution de la maladie d’Alzheimer. L’équipe a montré que divers variants structuraux d’Aβ induisent des troubles de la plasticité synaptique. Les chercheurs détermineront leur impact sur l’organisation du cytosquelette de neurones en culture, pour comprendre comment et quand les différents variants interagissent avec le cytosquelette et quelles organisations anormales ils favorisent.
- Projet 4 : Déterminer l’impact de la huntingtine pathologique sur le cytosquelette (équipe Humbert). La maladie de Huntington est causée par une expansion anormale dans la protéine huntingtine. Les données récentes de l’équipe indiquent que cette huntingtine anormale est capable de se lier directement à des protéines du cytosquelette. L’imagerie STORM-3D sera utilisée pour étudier les organisations spécifiques du cytosquelette induites par la liaison de l’huntingtine ainsi que pour déterminer comment ces organisations sont affectées par la présence de l’huntingtine mutée.
L’équipement

Utilisation de l’équipement
Le microscope haute résolution Zeiss LSM900/ Airyscan2 a été récemment mis en service sur la plateforme et est déjà utilisé par six équipes de l’Institut des Neurosciences de Grenoble. Cet instrument répond à une très forte demande d’utilisation en microscopie haute résolution pour une dizaine d’équipe de l’institut des Neurosciences et d’autres laboratoires académiques du site santé.
Les différentes équipes utilisent cet appareil de microscopie pour observer des neurones en cultures et des coupes de cerveaux de modèles murins de pathologies cérébrales incluant des maladies neurodégénératives et des maladies psychiatriques.
Premiers résultats
Les chercheurs étudient l’organisation du cytosquelette des neurones dans des conditions normales et pathologiques. Pour rappel, le cytosquelette est un ensemble de filaments présents à l’intérieur des neurones, formant un squelette nécessaire au bon développement et au fonctionnement de ces cellules.
En particulier, ils déterminent comment le cytosquelette est modifié en présence de protéines régulatrices qui deviennent dysfonctionnelles dans diverses pathologies du cerveau : 1/ la protéine tau dont la dérégulation est impliquée dans la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées, 2/ la protéine MAP6, associée à des maladies psychiatriques telles que la schizophrénie.
Leurs recherches montrent que ces protéines interagissent avec le cytosquelette dont elles modulent l’assemblage et la stabilité.
Les chercheurs ont notamment analysé une protéine MAP6 et sa localisation dans les neurones en utilisant la microscopie à haute résolution (voir Figure 1 ci-dessous). Les résultats montrent que cette protéine est présente dans les prolongements neuronaux (dendrite ou axone) et au niveau des cils primaires des neurones (voir Figure 2 ci-dessous). Ces cils primaires sont des petites antennes enrichies en microtubules (composant essentiel du cytosquelette), présentes à la surface des cellules et impliqués dans la réception des signaux extérieurs. Leur dysfonctionnement chez l’homme est associée à des troubles neuropsychiatriques et des maladies neurodégénératives.


Prochaines utilisations prévues
Les chercheurs prévoient de déterminer par microscopie haute résolution la localisation précise d’une protéine MAP6 sur des coupes de cerveaux de modèles murins dans différentes régions, ce qui donnera des hypothèses quant à son rôle. Ces expériences seront couplées à des études comportementales de modèles animaux déficients pour cette protéine.
Un autre projet en cours dans l’équipe concerne la protéine tau. Les chercheurs souhaitent déterminer précisément la localisation de tau dans différents compartiments neuronaux (axones, dendrites et synapses), et comment cette localisation est altérée lorsque tau subit des modification pathologiques retrouvées dans la maladie d’Alzheimer.
Photographies : Inserm, Pexels, Annie Andrieux

Le chercheur
Annie ANDRIEUX est Directrice de Recherche CEA à l’Institut des Neurosciences de Grenoble et co-responsable de l’équipe « Dynamique & Structure du Cytosquelette Neuronal » avec Isabelle Arnal. Elle est également actuellement présidente de la Société française des Neurosciences. Annie Andrieux s’intéresse principalement à la biologie cellulaire des neurones et est reconnue pour son travail sur le cytosquelette, en particulier sur les microtubules. Son équipe maîtrise diverses méthodes d’imagerie incluant des techniques de super-résolution et de cryo-microscopie électronique.
Témoignage d'Annie Andrieux, porteuse du projet
« Le financement du Rotary est essentiel pour ce projet car il nous permettra d’acquérir un système d’imagerie performant pour « voir » à l’intérieur des neurones. Ainsi nous pourrons visualiser à l’échelle nanométrique les filaments individuels qui constituent le cytosquelette et corréler cette organisation avec les changements de formes et l’activité du neurone. Le rêve ultime serait d’être capable de voir ce cytosquelette à cette résolution mais sur des cellules vivantes et donc d’accéder à leur dynamique » – Annie ANDRIEUX

Le centre de recherche
Cet équipement sera installé au sein de l’Institut des Neurosciences de Grenoble (GIN).